Philippe Labro, 71 ans, écrivain, journaliste, vice-président de la chaîne Direct 8 et des quotidiens gratuits Direct Soir et Matin Plus.

Dans son bureau, il est chez lui : photos de famille, portraits de ses maîtres (Hemingway, bien sûr), romans parus et traduits et reparus… C’est là, dans les locaux de Bolloré Médias à deux pas du Trocadéro, que Philippe Labro nous accueille un matin de juillet pour une interview fleuve. Près d’une heure de questions-réponses axées dans un premier temps sur son dernier ouvrage, « Des cornichons au chocolat », paru en janvier, et sur ses deux autres livres sur la jeunesse au féminin. La discussion aborde bientôt la vie du romancier et approfondit quelques-uns de ses thèmes clés : l’introspection, la nostalgie, le passage du temps… En voici les morceaux choisis, en texte et en images. Et, pour mieux connaître l’homme, un portrait écrit à la lumière de ses romans.
Interview (extraits) :

Philippe Labro, vous avez publié trois romans dans lesquels vous racontez les émois d’adolescentes. Comment vous est venue l’idée de délaisser le genre autobiographique pour vous mettre dans la peau de jeunes femmes ?
En écrivant mes romans autobiographiques, dans lesquels je me mets, déjà, dans la peau d’un adolescent, je me suis aperçu de deux choses. Premièrement, j’adorais me mettre à la première personne, et que le protagoniste principal dise « je ». Deuxièmement, la place que je donnais aux femmes dans mes romans signifiait l’intérêt que j’ai toujours eu pour elles. Et puis je vis dans un univers de femmes : mon épouse bien sûr, mais j’ai aussi une fille d’un premier mariage et une fille d’un second mariage. Ces enfants sont devenues des adolescentes, dont j’ai observé les comportements, écouté les langages et les codes, puisqu’un écrivain c’est quelqu’un qui absorbe en permanence tout… Ce qui a donc donné Stéphanie, l’héroïne de « Des cornichons au chocolat ». J’ai publié ce livre dans un premier temps sous un pseudo parce que cela m’amusait d’une part, et parce qu’à l’époque je me disais que personne ne pourrait croire qu’un homme déjà mûr puisse se mettre dans la peau d’une adolescente. Avec cette « trilogie féminine », qui s’est ensuite poursuivie avec « Manuella » et « Franz et Clara », j’ai aussi eu l’envie de sortir de moi-même pour aller explorer les états d’âme d’une génération autre, et d’un sexe autre que le mien, ce qui a été un exercice de fiction très intéressant.
N’est-ce que de la pure fiction ?
Non car un écrivain est toujours tous ses personnages. Et je considère que Manuella, en particulier, c’est moi à son âge ! Puisqu’un adolescent, homme ou femme, c’est toujours un adolescent : cet être jeune qui arrive dans l’existence et qui est confronté aux premières grandes épreuves, en l’occurrence pour Manuella, le Bac, la virginité, le premier amour…
Quels sont les points communs entre ces trois jeunes héroïnes ?
D’une certaine manière, ces filles ne sont qu’une ! On s’aperçoit qu’il y a chez les trois les mêmes composantes psychologiques, sentimentales, comportementales. Au fond, j’ai fait une concoction, un mélange, premièrement d’invention (il ne faut pas croire que tout cela est vrai !), deuxièmement d’observation globale de mes filles et de leurs copines, et puis enfin de conversations avec Françoise, mon épouse, qui m’a raconté des anecdotes de son adolescence. Et je crois que ce qui définit le mieux ces trois héroïnes, c’est le besoin de pureté. J’ai voulu leur donner également un poids de sérénité, de sagesse, de recul et de réflexion, de jugement sur la vie et sur les adultes, qui m’a toujours impressionné et séduit chez certains enfants et adolescents.

Stéphanie et Manuella sont des adolescentes complexées qui souffrent d’être en retard par rapport aux autres. Quel est le message que vous avez voulu transmettre ?
Elles se croient en retard – Stéphanie a 13 ans et n’a pas ses règles, et Manuella est vierge à 17 ans – alors que ce sont les lois de la vie : certains sont en avance, d’autres non. Et elles veulent être comme les autres, car un adolescent veut à la fois se distinguer du groupe, afficher son individualité, mais en même temps veut appartenir, veut être accepté, veut être admis, inclus. C’est cela la principale explication de leur complexe, que j’appellerais plutôt leur nature. C’est qu’elles veulent appartenir au groupe. Il y a une notion de groupe beaucoup plus importante dans les générations des années 80, 90 et 2000 qu’il y a cinquante ans. A l’époque, un adolescent n’avait qu’un ou deux amis, on ne s’envoyait pas de « textos » et on ne sortait par le soir ensemble. Ca n’avait rien à avoir avec aujourd’hui. Aujourd’hui, un adolescent doit appartenir à un groupe, à une sorte de nucleus de quatre, cinq, six membres… Mes héroïnes n’y sont donc pas et ça les fait souffrir, mais c’est pour cela que je les ai choisies. C’est aussi parce qu’elles correspondent à énormément de gens de leur âge, qui éprouvent ce même sentiment. Des Manuella, il y en a plus qu’on ne le croit !
Vous venez d’employer le verbe « se distinguer »… A quel moment de votre vie avez-vous pris conscience, vous Philippe Labro, que vous aviez une ambition et que vous pouviez vous distinguer de la masse ?
C’est très difficile à dire. Il n’y a pas un moment, ce n’est pas vrai, il y a des moments, il y a des saisons mentales et physiques, intellectuelles et sentimentales. Ca remonte à l’enfance, tout remonte à l’enfance… Je suis le troisième d’une fratrie de quatre garçons, avec des parents dont je crois – à tort ! – qu’ils accordent plus d’importance à mes frères aînés. Toute mon idée, enfant, est donc d’être à la hauteur des deux premiers, d’appartenir, d’être accepté, inclus. Ce sont ainsi les bases psychologiques, psychanalytiques même, qui expliquent la volonté d’un enfant de s’exprimer, d’être reconnu, d’être remarqué… Et il est vrai que j’étais un garçon qui passait son temps à se faire remarquer ! [Rires] Par ailleurs et parallèlement, j’avais certainement dans mes gènes – mon père a écrit quelques livres, ma mère adorait la littérature – un goût et un don du récit et du conte.
Vous évoquez souvent dans vos ouvrages, et notamment dans « Des cornichons au chocolat », la notion de « comédie ». C’est quoi, cette comédie ? Qui en joue, pourquoi ?
Cette comédie, je ne l’invente pas : Balzac en parle déjà, Shakespeare a dit que la vie n’était qu’une farce… La comédie, cela définit et résume une partie du jeu social, des échanges entre les gens. Est-ce qu’on est soi-même, est-ce qu’on joue un rôle ? Est-ce qu’on doit porter un masque ? Quel est le vrai naturel d’un être ? Est-ce qu’il ment, est-ce qu’il joue… ? C’est tout cela, la comédie. C’est une vaste notion. Et on peut considérer que, parmi les milliers de définitions de l’existence, la vie est une comédie. Concernant Stéphanie, dans « Des cornichons au chocolat », et Manuella, c’est un regard beaucoup plus critique puisqu’elles sont parfaitement conscientes que les « vieux », les adultes jouent des rôles, portent des masques, mentent, déguisent, transforment… Et cela les dérange car elles ont un besoin d’authenticité, de vérité.
Avez-vous un autre livre en projet actuellement ?
Oui mais je préfère ne pas en parler. J’en suis trop à mes débuts, je suis trop hésitant, je suis trop incertain. Et puis je n’aime pas du tout parler de ce que je fais au moment où je le fais, parce que cela détériore, dévirginise… Il faut garder cela pour soi. Il faut d’abord faire. C’est toujours pareil : il y a « savoir faire », et puis il y a « le faire savoir » : c’était la grande définition de Lazareff. Et c’est une évidence : quoi que vous fassiez -un livre, une maison, une campagne politique, une symphonie, un tableau, une balle de ping-pong… – vous le faites d’abord. Une fois que c’est fait, que cela commence à bien exister, que vous avez la conviction que cela ressemble à ce que vous souhaitiez que cela devienne, c’est à ce moment là seulement qu’il faut le faire connaître.
Morceaux choisis de l’interview
Un don pour le récit
Philippe Labro explique son besoin, dès l’enfance, de s’exprimer et son don de raconter.
Action et réflexion
Philippe Labro explique comment il a conjugué action et réflexion tout au long de sa vie.
La brièveté de la vie
Philippe Labro nous parle de la brièveté de l’existence et affirme que « nous sommes ce dont nous nous souvenons ».
Les leçons du passé
Philippe Labro explique ce qu’il a appris et compris en écrivant sur son passé.
Douce nostalgie
Philippe Labro distingue regret et nostalgie et conclut qu’on peut aussi « tout regretter ».
Les « puissances autres »
Philippe Labro nous parle de l’inintelligible, de cette part de mystère que personne ne contrôle.
Le sens du journalisme
Philippe Labro répond à la question : « Pourquoi être journaliste ? »
Pourquoi le passage du temps ?
Philippe Labro explique son penchant pour la notion du passage du temps et pour la nostalgie.
L’étudiant étranger
Philippe Labro lit un passage de son roman L’étudiant étranger, le moment où le jeune homme fait le bilan de son année aux Etats-Unis.
Philippe Labro, à la lumière de ses romans
Sa vie se lit dans ses romans, elle se confond avec son oeuvre. Voyons ce que des mots peuvent révéler d’un homme…
Note : chaque titre d’ouvrage est accompagné de sa date de parution
Le jeune homme et le Petit Homme
Dix-huit livres, sept long-métrages, quinze ans à la tête de RTL… Si on le sait écrivain, qu’on l’a connu metteur en scène puis directeur de médias, Philippe Labro est avant tout journaliste. Ce qui anime depuis ses débuts cet homme d’éclectisme, outre la passion, outre la curiosité, outre l’ambition aussi, c’est bien l’obsession de saisir l' »air du temps ». L’expression n’est pas de lui, elle vient de son maître en la matière, l’homme avec qui il fait ses premières armes à France-Soir à l’orée des années 60, le patron de presse légendaire qu’on avait coutume d’appeler le « Petit Homme » : Pierre Lazareff. A sa demande, le débutant Philippe Labro écrit un premier manuscrit, Un Américain peu tranquille (1960), pour le compte du grand quotidien de la rue Réaumur. L’Américain en question, c’est Al Capone. En racontant façon pastiche l’histoire du célèbre gangster des années 20, l’apprenti écrivain entend taper dans l’oeil du grand patron. Et y parvient. Lazareff est épaté, Labro embauché. Nommé grand reporter, il se verse tête la première dans le journalisme, dans ce fleuve impétueux dont il se met à suivre le cours si grisant. Presse écrite (Paris Match, Le Journal du dimanche), radio (Europe n°1, RTL) et télévision (TF1, Antenne 2), il touche à tout, goûte à tout. Il galope et caracole, s’affirme et s’aguerrit et surtout il fait, il bouge et il agit. Son activité est frénétique, absorbante. Elle est d’abord passionnante.
L’appel de la plume
Car pour Philippe Labro, le journalisme est avant tout passion. Il est aussi vocation. « Savoir et faire savoir » (encore Lazareff). Voir et dire ce qu’on a vu, ni plus ni moins que la « Chose vue ». L’expression vient cette fois de Victor Hugo, autre de ses maîtres (il en a d’autres encore). Fort de son savoir-faire, le professionnel de l’information accomplit donc sa vocation avec zèle. Seulement voilà, Labro a plus qu’un simple zèle. Il a un talent, il a un don. Ce don, c’est un ton, c’est un style, c’est une plume. Et cette plume le titille, le chatouille et l’excite et l’entraîne bientôt tout logiquement vers l’exercice de la fiction. L’homme de mots veut créer, inventer, imaginer. Il a 31 ans quand paraît Des feux mal éteints (1967), son premier vrai roman. Il y dresse le portrait de toute une génération d’hommes qui comme lui ont servi en Algérie pendant les « événements » et ont appris, là-bas, la vie, la guerre, et la mort… Déjà. Son deuxième roman, Des bateaux dans la nuit, ne sort que bien plus tard, en 1982. Entre temps, l’homme refait sa vie : divorce, se remarie. Et goûte au septième art. Il réalise sept films (« L’Héritier », « L’Alpagueur », « Rive droite, Rive gauche »…) et met en scène des Belmondo, Luchini et autres Depardieu. S’il admirait Lazareff et aime citer Hugo, au cinéma son mentor s’appelle Melville. Jean-Pierre Melville, metteur en scène de talent et ami regretté qui meurt d’une crise cardiaque dans ses bras, un soir, dans un restaurant du 13e arrondissement de Paris. La mort, encore. Il aura d’autres occasions de la revoir de près.
A l’encre du passé
Délaissant le grand écran, Philippe Labro marque, avec Des bateaux dans la nuit, son retour à l’écriture. Une écriture devenue plus mûre, plus dure, plus crue par moments. Le temps et ses épreuves n’y sont pas étrangers. Quinze ans après son premier roman, l’écrivain est parvenu à « monter d’un cran » – comme aurait dit son compère André Malraux – dans l’art du récit. Il confirme quatre ans plus tard avec L’étudiant étranger (1986, prix Interallié), premier d’un cycle de cinq romans autobiographiques sur ses années d’apprentissage. Et premier best-seller. On y découvre un Philippe Labro héros-narrateur des événements de sa jeunesse – de sa genèse -, couchant sur le papier les moments qui l’ont fait, qui ont formé la trame de son existence et forgé un destin qu’il ignorait sans doute alors. Trente ans plus tard, l’écrivain se prête donc au jeu du retour sur soi et manie un « je » qu’il conjugue au passé du nostalgique ; « ce « je » qui n’est plus moi et qui l’est, pourtant, profondément », écrit-il. Mélancolique, il l’est assurément au moment de tremper sa plume dans sa mémoire pour revisiter son autrefois, et se livrer à ses chimères, à ses fantasmes… Enfin ! Travestir, embellir, sublimer la réalité ! Ce que le journaliste s’est jusqu’alors abstenu de pratiquer dans l’exercice de son métier, le romancier s’autorise dorénavant à l’appliquer à son propre vécu.
L’Amérique, au fer rouge
L’étudiant étranger raconte ainsi son expérience dans les Etats-Unis des années 50. L’histoire débute un matin de janvier dans une classe d’un grand lycée de Paris où l’élève prépare son Bac. Ludwig van Beethoven disait des premières notes de sa Ve Symphonie qu’elles symbolisaient le destin qui frappe à la porte. Le destin, ce jour-là, s’incarne en deux hommes qui font irruption dans la salle de cours pour proposer une bourse d’études sur un campus américain. Le lycéen lève la main, répond à l’appel du destin et embarque quelques mois plus tard à bord du Queen Mary, cap sur le Nouveau Monde. Il devient « college boy » dans une prestigieuse université de Virginie. Le jeune homme a 18 ans. C’est l’âge des découvertes et des initiations, l’âge des premières fois qui laissent des traces indélébiles. Premier voyage, premier amour, premiers interdits bravés et premier contact avec une Amérique qui ne cessera dès lors de le fasciner. Ce continent qu’il avait découvert dans les récits de Jack London et Fenimore Cooper, voici maintenant qu’il l’embrasse et l’éprouve et l’explore jusqu’à l’arpenter d’est en ouest… L’Ouest ! Le Saint des Saints ! Pour l’atteindre, le « frenchie » parcourt 2000 kilomètres sur la route, le pouce levé. Il y passe l’été, Un été dans l’Ouest (1988, prix Gutenberg), où il endosse l’habit de bûcheron et s’échine à purger d’insectes une forêt du sud-ouest du Colorado. Plus que le travail harassant, plus que les affres des routes traversées, plus encore que la rudesse imposante des hommes de l’Ouest, c’est la beauté du pays qui le frappe et le marque. Ces forêts, ces montagnes, ces grands espaces, ces couleurs uniques : rien ne l’y avait préparé.
Un astre en devenir
Trois romans complètent son cycle autobiographique. Le Petit garçon(1991) retrace son enfance dans la villa familiale de Montauban, où il est né en 1936. Il y passe les douze premières années de sa vie avec son père, sa mère et ses trois frères. L’enfance… C’est donc là que tout commence, que tout s’esquisse et tout se tresse et tout se trame. Le don du récit, le besoin d’être reconnu, le désir de se distinguer… « Au centre du cercle familial, c’est moi qui raconte », se souvient-il. Petit garçon déjà, c’est lui, le narrateur. L’enfant grandit, monte à Paris, entre dans l’adolescence. Il a Quinze ans (1993), l’âge ingrat, informe, incertain. Il a pourtant la certitude, sur les bancs du lycée Janson-de-Sailly du 16e arrondissement, qu’il ne doit pas abîmer sa vie dans la médiocrité. Comme un serment, une promesse, celle de ne pas demeurer éternellement dans cet état de nébuleuse. Le lycéen remporte un concours de journalisme : la nébuleuse, déjà, soumise aux forces de l’ambition, s’assemble et se condense et compose peu à peu l’étoile qu’elle deviendra. Car l’adolescent mûrit, devient adulte, jeune homme. Il a 20 ans, revient d’Amérique, pénètre le monde de la presse parisienne et découvre l’atmosphère enivrante d’une salle de rédaction. C’est son baptême du feu, c’est Un début à Paris (1994), fresque d’une époque révolue – l’insouciance, l’effervescence des années 60 ! – et portrait d’une Ville-Lumière dont aujourd’hui l’éclat n’est plus. Plus le même, s’entend.
La mort, aller et retour
« Quoi qu’il arrive, j’apprends. Je gagne à tout coup ». Les mots de Marguerite Yourcenar qui ouvrent Un début à Paris sont éloquents. Mais sans doute Philippe Labro ne prend-il pas, au moment de citer une de ses auteurs fétiches, toute la mesure de cette formule. Car à peine achève-t-il son roman qu’un grave accident respiratoire le foudroie. Il passe dix jours en réanimation à l’hôpital Cochin. La mort, encore elle. Cette fois c’est lui qu’elle veut. Il la sent proche (« juste derrière, à gauche »), il l’entend, il la voit. Et va la traverser. Allongé sur son lit, il connaît deux « EMA » : expériences de mort approchée, qu’il décrit dans un témoignage, La traversée (1996). Récit tellement invraisemblable qu’il avertit le lecteur, dès les premières pages : « Ceci n’est pas un roman ». Non, cette fois le romancier, l’affabulateur s’efface pour raconter ce qu’il a vu (ni plus ni moins que la Chose vue). Et ce qu’il a vu le transforme. Revenu de l’abîme, il « gagne ». Car il « apprend ». Il apprend à rire de soi, il apprend à relativiser. Il réalise la précarité de l’existence et redécouvre l’amour, de la vie et des siens. Reste à savoir pourquoi, sur son lit de douleur, lui sont revenues, obsédantes, ces visions des sapins bleus du Colorado de sa jeunesse… Et d’où vient Karen, l’infirmière de nuit coréenne qu’il craignait tant mais qui n’a jamais existé que dans ses délires funestes ? Il veut comprendre. Les explications des médecins ne lui conviennent pas. Trop rationnelles. Le mystère dépasse la raison, transcende l’intelligible. La réponse, il doit la trouver en lui-même, en son passé. Il se donne donc Rendez-vous au Colorado (1997). Retour dans l’Ouest, retour dans le temps. Les sons, les effluves et les visions et la beauté qu’il y retrouve ravivent en lui les souvenirs les plus enfouis, les plus profonds. Et résolvent l’énigme.
Moi, Manuella
Une page se tourne. Son passé, sa mémoire, l’écrivain les a assez étudiés, contemplés. Il est temps de changer de « je », de changer de jeu. Mai 99, Philippe Labro délaisse son Moi à lui et joue Manuella. Elle est lycéenne, elle a 17 ans, elle est vierge. Elle est donc en retard, croit-elle. Et en souffre. Un autre désarroi poursuit Stéphanie, sa « petite soeur » dans Des cornichons au chocolat (2007). Elle, n’a pas encore ses règles, à 13 ans. S’intégrer tout en se distinguant : le même double désir tiraille ces deux adolescentes. Le même besoin, aussi, d’authenticité, le même rejet de la comédie, du « je » social. L’auteur dit « moi » et dit l’émoi de ces jeunes filles dans ces journaux intimes fictifs. Intimes, ils le sont. Fictifs, déjà moins. A bien y penser, ils auraient pu être les siens, à un sexe près. L’espace d’une trilogie, l’homme qui avait tant aimé les femmes dans ses romans les incarne donc pour leur faire dire les mots que seuls, à cet âge, la pureté et le génie de l’innocence éveillent… Trilogie ? La troisième s’appelle Clara. Elle a 20 ans et s’éprend de Franz, 12 ans, sur un banc à Genève. Franz et Clara (2006) nous prouvent que l’amour ignore les âges, puisque c’est l’amour.
Le pouvoir, ce trou noir
Fin 99, Philippe Labro est au sommet de la réussite. Manuella est un succès, sa carrière aussi. Directeur des programmes de RTL depuis près de quinze ans, il est en passe d’accéder à la présidence de la station. Comble d’un parcours brillant, ultime marche de son ascension jusqu’au pouvoir. Mais voilà que l’homme chute, craque, se brise. Plus de désir, plus de goût, plus de vie. « J’sais pas ce que j’ai. Ca va pas ». Sa femme et leurs deux enfants ne le reconnaissent plus. A Paris, la rumeur enfle : Labro est « foutu ». Car Labro est malade. Cinq ans après sa traversée, il replonge dans l’abîme. Un abîme tout autre. C’est la maladie qui broie de l’intérieur, la maladie qui ne veut pas dire son nom. Cette maladie, c’est la dépression. Philippe Labro la raconte dans Tomber sept fois, se relever huit (2003), et atteste qu’elle touche, aussi, des êtres de sa trempe. La question est pourquoi ? Le vertige du pouvoir – qu’une partie de lui rejette en sourdine – ; les gènes d’un père hanté par l' »Inquiétude » et d’une mère abandonnée dès l’enfance… Les causes sont multiples pour expliquer la chute. A-t-il pensé, pendant les onze mois que dure son « novembre de l’âme », à cette phrase d’Ernest Hemingway, son maître d’écriture : « L’homme peut être détruit, mais jamais vaincu » ? Car si la dépression le terrasse, elle ne le défait pas. Il se relève. Comme à chaque fois qu’il est tombé dans sa vie… Le grand Ernest avait raison.
Le « je » défendu
Il reprend sa route. Quitte RTL, retrouve son élément : le terrain. Il rencontre Villepin et Schrameck, les hommes de l’ombre de l’Elysée et Matignon, et en fait un portrait croisé. Lequel conclut Je connais gens de toutes sortes (2002), galerie de portraits revus et commentés où se côtoient des Kennedy, des Mitterrand et des Goldman. Vingt-et-un papiers au total, parus dans Vogue, Le Point et Le Monde ces trente dernières années. On y redécouvre la plume du portraitiste qui croque jusqu’aux moindres faits et gestes de ses interlocuteurs. Et croque aussi le fruit défendu du journalisme : le « je » (toujours lui) qui parle et s’expose et se met en scène… Mais quand le « je » s’appelle Labro, ce n’est rien qu’un péché mignon. Le goût du portrait, il l’assouvit ensuite à la télévision. De 2002 à 2006, il présente Ombre et lumière, le mercredi, tard le soir sur France 3. Des entretiens intimistes avec d’autres « gens de toutes sortes », dans la pénombre et à une heure où l’on s’épanche sans réticence. La télé, toujours, mais ailleurs : novembre 2005, il lance la chaîne Direct 8, sur la TNT, avec son ami Vincent Bolloré dont il est le conseiller médias. A partir de la rentrée, il y présentera chaque jour après les JT son Edito, au cours duquel il livrera ses impressions sur l’actualité, continuant de renifler le toujours changeant air du temps… La TNT, donc. Nouveau territoire à débroussailler, nouvel inconnu à explorer…
« Que reste-t-il… »
Voilà donc ce qu’il n’a cessé de faire, sa vie durant : explorer l’inconnu. De Paris à l’Amérique, de la presse au petit écran, de l’écriture au cinéma, l’homme a toujours cherché l’ailleurs, l’inassouvi, des terres nouvelles où progresser et rassasier son éternelle curiosité. Comme un perpétuel besoin d’apprendre, besoin de comprendre. Besoin de défis, aussi. Besoin de mouvement, surtout. Bouger et s’aviver et s’agiter pour demeurer aux avant-postes… Ou pour chasser un doute latent. Mais le temps passe et les mots coulent et arrive l’heure de faire les comptes. Des chances et des failles, des réussites et des échecs, des parts d’ombre et de lumière. Pour ce portrait, laissons l’ombre dans l’ombre et voyons ce que l’astre a fait de sa lumière… « Dis, qu’as-tu fait de ton talent ? », questionne-t-on dans la Bible. « Qu’en as-tu donc fait », Philippe Labro, et qu’en restera-t-il ? Dix mille articles de presse (quinze mille ?), sept films et une radio gérée pendant quinze ans, sans parler d’une influence peu quantifiable sur nombre d’hommes et de femmes, et d’une famille dont les enfants sont maintenant grands. Et puis dix-huit livres – et d’autres encore à venir – dix-huit romans-miroirs à peine déformants d’un « je » et d’une vie. C’est donc l’empreinte qu’il laissera, c’est donc cela, son oeuvre.
Son « travail », corrigera-t-il. Le mot « oeuvre » s’applique à Malraux ou à Hemingway, pas à lui. Pas encore, lui rétorquera-t-on. Le temps seul appréciera…
Bibliographie de Philippe Labro
Chez « Gallimard », disponibles en « Folio » :
« Un Américain peu tranquille », 1960
« Des feux mal éteints », 1967
« Des bateaux dans la nuit », 1982
« L’étudiant étranger, 1986
« Un été dans l’Ouest », 1988
« Le petit garçon », 1991
« Quinze ans », 1993
« Un début à Paris », 1994
« La traversée », 1996
« Rendez-vous au Colorado », 1997
« Manuella », 1999
« Je connais gens de toutes sortes », 2002
« Tomber sept fois, se relever huit », 2003
« Franz et Clara », chez Albin Michel, 2006
« Des cornichons au chocolat », chez JC Lattès, 2007 (d’abord paru en 1983 sous le pseudonyme de Stéphanie)
Auxquels s’ajoutent :
« Ce n’est qu’un début. Les barricades de Mai 68 », en collaboration avec Michèle Manceaux ; chez JC Lattès, 1968
« Tous célèbres », chez Denoël, 1979 ; recueil de portraits
« Lettres d’Amérique ». Un voyage en littérature, en collaboration avec Olivier Barrot ; paru chez Nil Editions en 2001 et en Folio depuis 2004

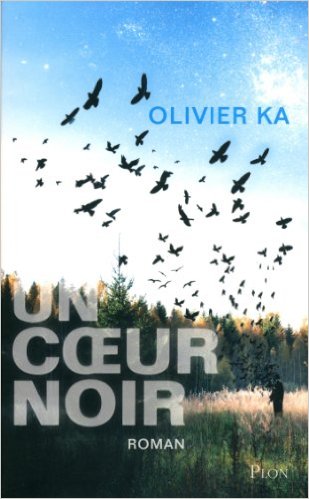
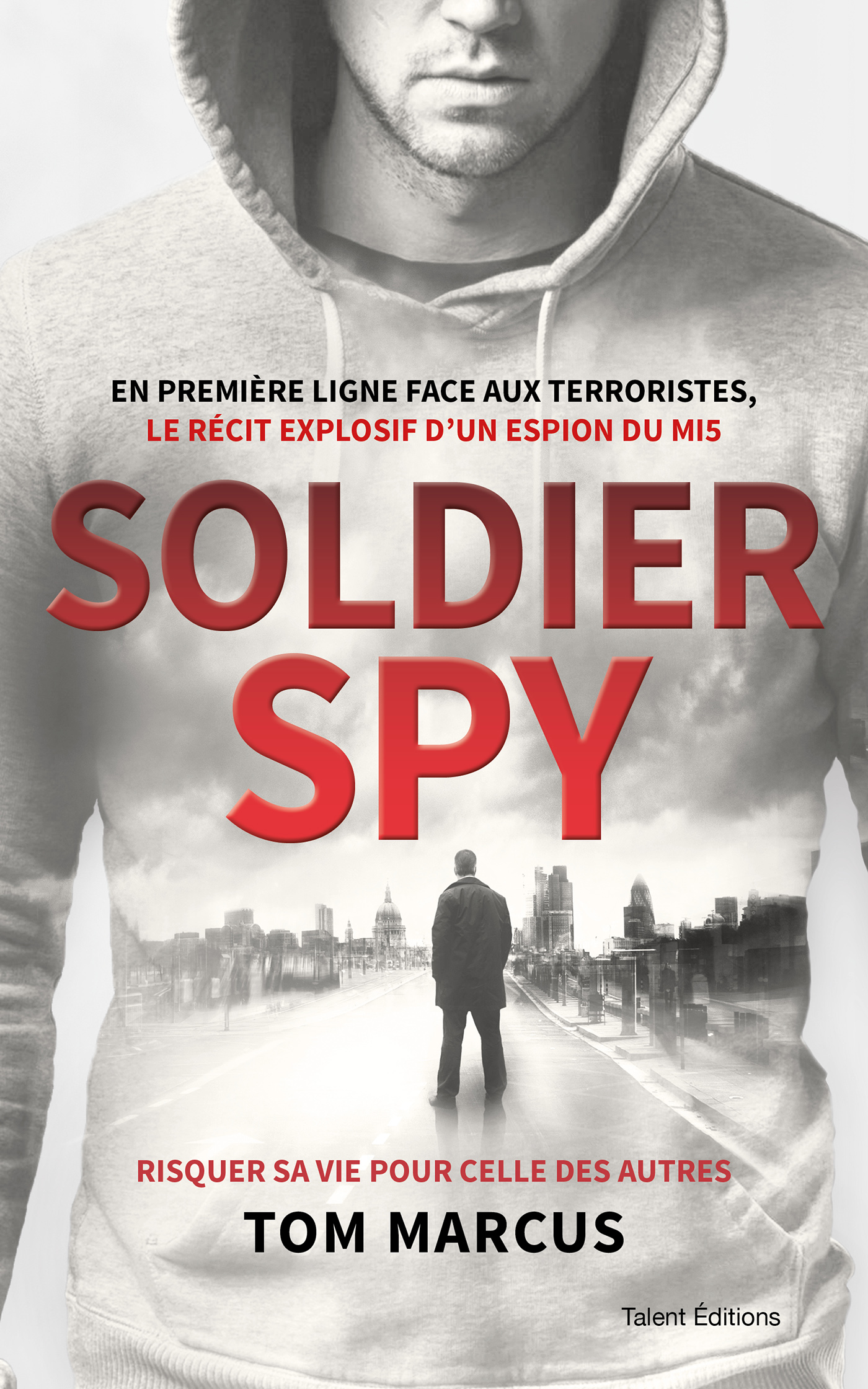
No Comments