
Une liaison passionnelle entre une femme de ménage muette nommée Elisa (Sally Hawkins), rebus de la société puritaine, et une créature mi-humanoïde et mi-amphibien (Doug Jones), objet de curiosité pour un laboratoire réputé ; voilà le projet le plus personnel de Guillermo Del Toro, dont il occupe la triple casquette de coproducteur, coscénariste et bien entendu réalisateur. Créateur d’un bestiaire monstrueux des plus fascinants, entre les vampires dotés d’une mâchoire exacerbée dans Blade II (2002) ainsi que le faune et l’ogre aux paires d’yeux incrustés dans ses mains dans Le Labyrinthe de Pan (2006), en passant par le marché troll dans Hellboy II (2008), Del Toro a développé tout au long de sa carrière un amour sincère voué à ces créatures d’apparence repoussantes mais profondément fragiles. Il nous le prouve encore avec La Forme de l’eau, romance surnaturelle sur fond de Guerre froide. Récompensé à La Mostra de Venise en 2017 et à la 90e Cérémonie des Oscars, son dixième long-métrage se veut comme la consécration de sa carrière, une ode à la différence nourrie de ses inspirations cinéphiliques les plus chères.

Le premier plan du long-métrage s’ouvre tel un conte de fées : une voix nous introduit à cette romance idyllique entre une princesse sans voix et son prince charmant monstrueux à travers la vision d’un appartement à l’atmosphère aquatique. Le réalisateur mexicain, fort de son univers singulier, applique soigneusement une esthétique onirique au cadre de l’Amérique des années 60. Les décors sont ainsi touchés par la couleur vert-bleuâtre, associée à la créature résidant dans le laboratoire, tandis que les rêves d’Elisa prennent vie sous forme de morceaux de comédies musicales insouciantes. Pourtant, cet univers hors du temps se confronte bien à la réalité cruelle d’une Amérique conservatrice, représentée par l’agent de sécurité Strickland (Michael Shannon), antagoniste du film, homme de loi sans pitié et père de famille ; un modèle pour son époque. C’est précisément cet entrecroisement de réalités contraires qui fait le charme suranné de ce long-métrage. La beauté du film tient à l’idée d’un amour impossible qui se tisse sans préjugé sous la vigilance d’une autorité oppressante.

Plus qu’une esthétique léchée, La Forme de l’eau plonge son spectateur au cœur d’un jeu de destins croisés, dans lequel chaque personnage de l’histoire ne se sent pas à sa place dans un monde construit sur des préjugés. Même l’agent de sécurité, qui représente une menace constante durant tout le long-métrage, se montre insatisfait de sa place sociale, agacé par sa vie de famille et commandé sans cesse par ses supérieurs. En véritable monstre humain, il répond uniquement par la violence envers autrui pour se défendre contre la cruauté de la société qui le domine insidieusement. Dans cet angle-là, la notion de monstruosité dans le film de Del Toro se révèle chancelante. Encore une fois, le cinéaste mexicain fait preuve de tendresse envers le monstre qui est rejeté par l’esprit rationnel des hommes, thématique-phare des films de monstres produits par Universal Pictures entre les années 1930 et 1950 – on peut citer par exemple Frankenstein de James Whale (1931), Dracula réalisé par Tod Browning (1931), L’Homme Invisible aussi de James Whale (1933) ou encore L’Etrange Créature du Lac Noir de Jack Arnold (1954), le plus apparenté à l’histoire d’amour conçue par Guillermo Del Toro. Or, la romance dépeinte dans La Forme de l’eau, est essentiellement pure et agit comme un vecteur de sentiments refoulés. La relation entre Elisa, la femme de ménage, et la créature aquatique se développe à la fois de manière poétique et charnelle. Entre le rêve teinté de nostalgie et le drame social sous couvert d’une touche fantastique, le nouveau long-métrage de Del Toro témoigne surtout d’un certain savoir-faire pour mettre en scène sur pellicule une romance au-delà des conventions et des genres.

Drame fantastique à fleur de peau, La Forme de l’eau (de son titre original The Shape of Water), réalisé par Guillermo Del Toro, possède un charme certain et cristallise toutes les obsessions du cinéaste mexicain, évoquant la cruauté humaine à travers les conflits historiques, le monde magique caché au sein du réel et la présence inexorable du temps. Sorti en vidéo depuis le 30 juin, le long-métrage est avant tout une œuvre sensible, imbibée de la passion férue de son réalisateur, et qui se savoure comme un conte de fées faisant l’apologie des différences.

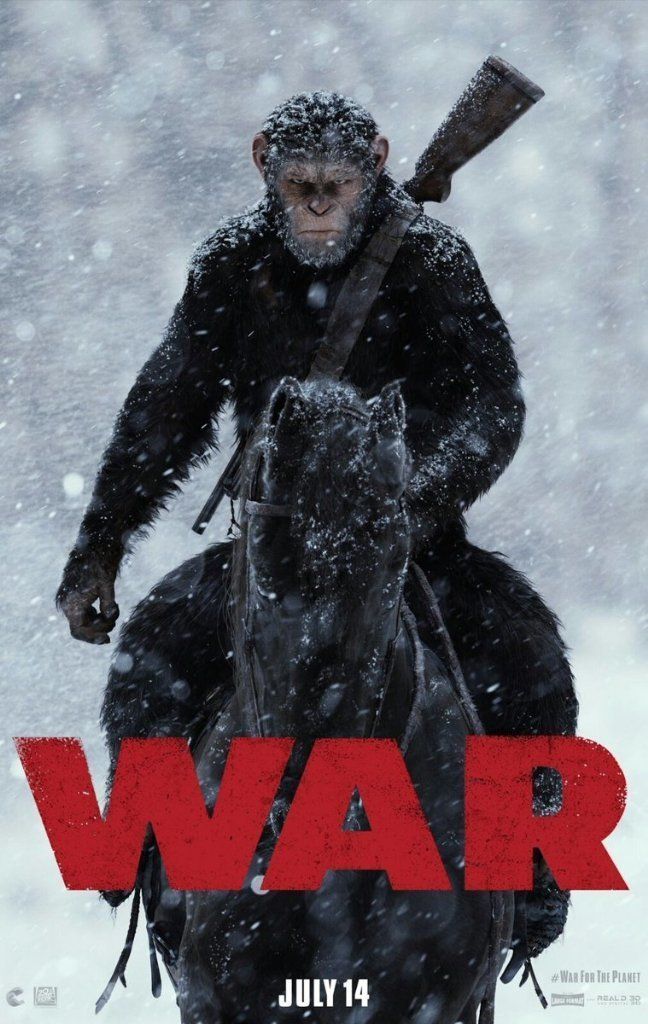

No Comments