A l’heure où Frankenwinnie sort en DVD, il est temps pour nous de revenir sur l’actualité de Tim Burton en 2012, qui fut riche en événements, à commencer par son exposition dédiée à la Cinémathèque Française.
Séance de dédicace (périlleuse) :
L’œuvre artistique de Tim Burton est enfin exposée devant le monde entier cette année. Et quoi de plus normal que l’artiste vienne en personne assister à ce spectacle. A l’occasion de cet évènement, une séance de dédicace avec le cinéaste était organisée le dimanche 4 mars 2012 à la Cinémathèque française, de 14h à 16h30. Admirateur de son univers, le petit garçon de 8 ans ébahi devant Beetlejuice (1988) était impatient d’arriver à cette journée. Bien que je craignais ne pouvoir l’apercevoir, je gardais un espoir au fond de moi de pouvoir le rencontrer.

Présent à 11h30, une queue gigantesque envahissait d’une manière monstrueuse la rue. Cependant, fort de mon optimisme de fan aveuglé, je restais au sein de cette foule de plus en plus grandissante. C’est à ce moment précis que je me rendais compte que l’univers de Tim Burton touche véritablement chaque génération de façon différente. Enfants, adolescents, jeunes étudiants et adultes étaient tous présents sans exception. Faut-il comprendre que ses films peuvent concilier tous les publics tout en gardant sa patte si personnelle ?
Malgré cette question, une évidence vient à moi : il est 16h15 et je demeure toujours aussi loin de l’entrée de la Cinémathèque. Après 4 heures 45 d’attente interminable sous la pluie battante, mes chances de rencontrer le cinéaste admiré depuis mon enfance sont vaines. Tout à coup, au moment de partir, un surveillant de la Cinémathèque se faufila dans la queue afin d’avertir aux gens que la séance allait finir. En me voyant en fauteuil roulant, il m’autorisa soudainement d’entrer à la Cinémathèque. Tout impatient et la tête dans les nuages, je cherchais du regard Tim Burton alors qu’il était à ma droite.
Assis devant une table, il me présenta une main amicale et me signa avec plaisir le catalogue de l’exposition ainsi que le recueil de ses dessins. Etant à la même hauteur que lui assis, il m’était plus facile de le voir en vrai devant moi. A ce moment, je me lançais dans une petite conversation avec lui : je fus à mon grand étonnement aisé en parlant devant lui ; il m’écoutait attentivement et semblait être doté d’une tendre patience. Je lui fis comme cadeau une de mes propres histoires écrites et illustrées. Regardant mon livre avec un grand sourire, il m’encouragea à continuer ma créativité, me serra la main et s’empressa de me saluer avant mon départ. Dans cette formidable rencontre, je perçois en Burton un homme simple, ouvert à ses admirateurs et patient. Il semble être un cinéaste beaucoup plus à l’aise au naturel qu’en interview improvisé et il dégage une profonde sincérité en rapport avec ses fans. Enfin, je sortis les yeux illuminés et le sourire éclatant à la fin de cette première journée.
Bilan de la Master-Class (intéressante) :
Le jour suivant, lundi 5 mars, Tim Burton était (re)venu pour une entrevue exclusive au sein de la Cinémathèque. Assistant à cette entrevue, j’ai pu percevoir en Burton un être cette fois timide mais essayant de véhiculer ses passions. En outre, il expliquait surtout avec précision en quoi la création artistique palpable à partir d’un dessin faisait partie de lui. Enfant, il n’arrivait à s’exprimer que par images transmises sur papier ou sur pellicule. S’il a gagné un peu plus d’assurance en parole ces temps-ci, ses sentiments demeurent toujours perceptibles par des images de son inconscient. C’est l’idée de la déformation de la réalité qui lui permet d’aborder un monde personnel, façonné à l’aide de son propre imaginaire. Le cinéaste insiste notamment sur sa relation avec l’animation image par image : cette technique lui sert à broder un univers proche du réel selon sa créativité illimitée.

Il affectionne cette animation parce qu’elle procure tout simplement des émotions chez le spectateur qui regarde une figurine s’animer devant lui. Ce travail renvoie à celui d’un maître de l’illusion ; Burton admire les magiciens qui donnent l’illusion au spectateur des choses inanimées s’animer. Et c’est là le point principal de son amour pour les séquences d’animation en tout genre : pouvoir donner la vie à des objets immobiles. Il trouve cette possibilité dans l’animation image par image. Le travail effectué sur ces poupées est aussi bien méritant que l’animation de synthèse. Le tournage se déroule de deux à trois ans de travail, dont une minute de film est équivalente à une semaine. Tim Burton valorise l’animation traditionnelle face aux images de synthèse. Ce sont les traits et souvent la perfectibilité du dessin qui le rend selon lui beaucoup plus fascinant et envoûtant. Le cinéaste avoue admirer le travail de Hayao Miyazaki car c’est l’un des seuls réalisateurs à rester attaché au dessin traditionnel, ce qui rend ses films authentiques. Pendant cette entrevue, Burton fait un tel éloge aux techniques de cinéma traditionnelles à tel point que l’on peut se demander s’il garde une certaine nostalgie du passé. Et l’extrait d’Ed Wood diffusé devant le public, montrant la manière de faire un film à petit budget, n’est pas là pour démentir cette impression…
Visite de l’exposition (attractive) :
Enfin, le mercredi 7 mars est arrivé ! La Cinémathèque ouvre ses portes et un amas monstrueux de personnes se précipite à l’entrée de l’exposition. Tapissé d’un mur sous fond de rayures horizontales noires et blanches, le couloir regorge de trouvailles visuelles originales et truculentes. Dans cette galerie, nous trouvons une multitude de dessins faits par Burton. Sa folie créatrice contamine le papier à dessin, les carnets de voyage et même les serviettes de bain.

A travers le parcours du cinéaste illustré ici, de nouvelles pièces comme des livres d’étude, des accessoires de ses films et des courts-métrages perdus s’offrent au spectateur. Cela montre à quel point le dessin est pour Burton de matérialiser ses sentiments. La galerie fourmille en outre de techniques d’illustration très variées : le dessin à l’aquarelle et à la peinture, les figurines sculptées, les photos remaniées, les films tournés en super 8, etc. Ces techniques permettent de fabriquer des personnages singuliers, intrigants et fascinants. Par exemple, le court-métrage méconnu de Hansel & Gretel en 1982 prouve que la frontière entre le dessin et la sculpture pour le cinéaste est définitivement très mince. Naviguant entre un ton lugubre et lyrique et des idées exubérantes et vives, Tim Burton façonne un monde intérieur qui peut parler de la mort avec une folie enfantine.

Fasciné par l’univers du cirque et la solitude des êtres monstrueux et fragiles, les figurines articulées sont suffisamment conformes à leurs esquisses. Cela est dans le but d’exprimer librement les idées qui émergent de l’imaginaire de Burton. Dans cette galerie de portraits, il se présente devant le spectateur une famille incongrue, grotesque, mais pourtant attachante dans un monde excentrique, hostile et coloré. Ce sont ses personnages insolites et intéressants qui représentent les émotions de leur créateur. Tantôt tristes, extravertis, joyeux, terrifiants et lubriques, ces protagonistes incongrus sont proches du cinéaste mais également du spectateur.

L’univers personnel de Tim Burton touche le cœur de tous les publics – enfants et adultes ; l’expression libre du cinéaste dans ses œuvres est d’autant plus fascinant, à tel point que le spectateur arrive à s’attacher à cet univers intime qui arrive avec sa sincérité à mettre en scène des thématiques universelles et sublimes – en outre, l’essence de l’univers de Tim Burton.

Dark Shadows : un exercice de style brut mâtiné d’images psychédéliques amères

A Hollywood, il existait un projet cinématographique qui avait la capacité de dissuader chaque producteur à le financer. C’était Dark Shadows, transposition d’une série télévisée créée par Dan Curtis, sur grand écran. S’étendant de 1966 à 1971, elle est désormais sacralisée en Amérique, mais demeure inconnue en France. Ce feuilleton peut être comparé à une variante abracadabrantesque des Feux de l’Amour, puisqu’il reprend le principe de péripéties relationnelles se suivant entre chaque épisode. Comptant un total de 1 225 épisode

s, l’histoire principale est celle de la famille Collins, sortes d’aristocrates bizarres subissant une malédiction au sein de leur manoir. A la base une série dramatique, le personnage de Jonathan Frid, le mystérieux vampire Barnabas Collins, arrive au 202ème épisode afin de remonter l’audience. Sa venue correspond à un tournant majeur de la série : sorcières, zombies et spectres s’invitent tour à tour dans cette aventure absurde. Passant du noir et blanc à la couleur, du fantastique à la science-fiction, le Dark Shadows original était connu pour son mélange de genres improbable et son ton gothique épuré de romantisme. Seulement, le résultat final donnait un soap opera de bas-étage, avec des maladresses techniques digne d’un film de série B et d’incohérences scénaristiques. L’aspect involontairement comique de l’ensemble renversait le ton dramatique. Mais, fort de sa notoriété, Dan Curtis réalisa deux films ultérieurs à la série : House of Dark Shadows (1970) suivi de Night of Dark Shadows (1971) qui approfondissait l’histoire initiale sous un angle différent. L’univers de la série détenait à ce moment-là une aura culte auprès des téléspectateurs américains.

A Hollywood, il existait un projet cinématographique qui avait la capacité de dissuader chaque producteur à le financer. C’était Dark Shadows, transposition d’une série télévisée créée par Dan Curtis, sur grand écran. S’étendant de 1966 à 1971, elle est désormais sacralisée en Amérique, mais demeure inconnue en France. Ce feuilleton peut être comparé à une variante abracadabrantesque des Feux de l’Amour, puisqu’il reprend le principe de péripéties relationnelles se suivant entre chaque épisode. Comptant un total de 1 225 épisodes, l’histoire principale est celle de la famille Collins, sortes d’aristocrates bizarres subissant une malédiction au sein de leur manoir. A la base une série dramatique, le personnage de Jonathan Frid, le mystérieux vampire Barnabas Collins, arrive au 202ème épisode afin de remonter l’audience. Sa venue correspond à un tournant majeur de la série : sorcières, zombies et spectres s’invitent tour à tour dans cette aventure absurde. Passant du noir et blanc à la couleur, du fantastique à la science-fiction, le Dark Shadows original était connu pour son mélange de genres improbable et son ton gothique épuré de romantisme. Seulement, le résultat final donnait un soap opera de bas-étage, avec des maladresses techniques digne d’un film de série B et d’incohérences scénaristiques. L’aspect involontairement comique de l’ensemble renversait le ton dramatique. Mais, fort de sa notoriété, Dan Curtis réalisa deux films ultérieurs à la série : House of Dark Shadows (1970) suivi de Night of Dark Shadows (1971) qui approfondissait l’histoire initiale sous un angle différent. L’univers de la série détenait à ce moment-là une aura culte auprès des téléspectateurs américains.

L’histoire du film est donc centrée sur Barnabas Collins (Johnny Depp), un aristocrate du XVIIIe siècle et un séducteur imbu de lui-même, qui entretient un marché maritime florissant à Liverpool. Trompant le cœur de sa servante Angélique Bouchard (Eva Green), celle-ci use de ses pouvoirs de sorcière pour maudire l’héritage familial et transformer son maître en vampire enterré vivant par ses villageois. Réveillé accidentellement en 1972, le vampire déchu se retrouve perdu dans une guerre sans merci qui oppose sa nouvelle famille infortunée contre la fameuse sorcière, réincarnée en femme d’affaires redoutable.

Tout d’abord, l’adaptation cinématographique de Tim Burton prend un parti-pris risqué : celui de faire cohabiter d’une manière pertinente le film gothique et l’habillage des années 70. L’esthétique du film offre un résultat singulier et vraiment intéressant : vient se mêler l’architecture médiévale et raffinée du manoir aux ustensiles colorés comme les lampes à lave. Il y a là un mariage décalé entre l’univers du vampire et celui de ses héritiers. Par exemple, Barnabas est affublé d’un teint blafard et de griffes tranchantes, tandis que les bibelots de la famille sont présentés comme des objets rutilants et caractéristiques de leur époque. En cela, Bruno Delbonnel, le directeur de la photographie, a très bien compris comment amener ce décalage artistique et livre une photographie sublime, entre des contrastes très prononcés et très vifs. L’ensemble des décors est aussi important dans le film. Après le tournage en fonds verts d’Alice, Burton a insisté pour minimiser les effets spéciaux numériques. Il retrouve son ancien directeur artistique attitré depuis son premier court métrage Vincent (1982), Rick Heinricks. Cette volonté de garder de vrais décors construits sur mesure, comme le manoir des Collins, rend l’univers du film plus palpable. Cela permet au spectateur – et aux acteurs – de s’impliquer véritablement dans l’atmosphère du long-métrage. Ainsi, le soin du détail apporté à chaque lieu éveille notre curiosité et donne à l’esthétique du film une atmosphère fascinante et unique grâce à ces contrastes d’ambiance.

Mêlant l’esthétique gothique à un visuel plus excessif, le film dissimule ce décalage à travers son atmosphère. En effet, on assiste à un mélange entre le film d’épouvante et la comédie déjantée. Si le début permet de distinguer ces deux aspects, plus l’histoire avance et plus les deux genres se confondent. Oscillant entre les envolées lyriques et les moments burlesques, la comédie burlesque de départ devient un opéra gothique avec une pointe d’humour ironique. Dans ce folklore incongru de genres divers (drame familial, tragédie romantique, épouvante), Tim Burton se consacre à un exercice de style qui confond ses deux aspects de sa filmographie. Les évènements du passé ont une ambiance familière à Sweeney Todd (2007) tandis que la confrontation entre le vampire et les hippies possède le même cynisme impertinent présent dans Mars Attacks! (1996). Le réalisateur joue avec ces deux facettes et l’ensemble est tellement disparate qu’il peut troubler le spectateur. En soi, cela reste fidèle à la série dans la profusion d’intrigues et le mélange de tons contradictoires.

Le film peut être perçu comme une parodie des films de monstres classiques, tant le personnage de Barnabas Collins se trouve ridiculisé par certaines situations cocasses. Le vampire est perdu dans une époque qui va à l’encontre de toute son autorité. Le comique de situation vient alors perturber la dramaturgie de sa quête, dès l’instant de sa résurrection. Cet atout comique enchaîne entre l’ironie et l’humour potache, ce qui donne un attrait particulier à l’histoire. La parodie du monstre classique, visible par le pastiche de l’éveil de Nosferatu, peut aussi être considéré comme un hommage amusant aux films d’épouvante des années 30. Dans ce cas-là, Barnabas apparaît comme un frère éloigné du Dracula joué par Bela Lugosi, jusque dans ses mimiques. Mais l’importance du cadre des années seventies fait référence aux pastiches de monstres, comme Blacula (1972). Si le décalage entre le vampire et les années 70 prône au milieu du film, Burton accorde de l’importance aux dialogues pour introduire son humour caustique. Ainsi, jeux de mots, allusions sexuelles et principalement choc des cultures se multiplient à foison, osant même intégrer un concert déchaîné d’Alice Cooper au plein cœur d’un gala aristocratique. Le long-métrage fait penser à une farce avec ses personnages tous irrécupérables, qui semblent virer presque à la caricature. Mais, à chaque scène, le cinéaste arrive à ajuster l’humour du film afin d’intégrer parfaitement cet humour bigarré dans la dramaturgie de l’histoire.

En parlant de l’histoire, le scénario, malgré sa réécriture, est habile dans l’évolution de son intrigue. Barnabas Collins incarne un parfait héros tourmenté, victime de son sort mais l’usant à ses fins personnelles. Renouant avec le vampire traditionnel, Johnny Depp se fait tour à tour glaçant et menaçant dans la peau de ce vampire en quête d’identité. Son personnage ainsi que celui d’Eva Green ont une évolution intéressante. Se prétendant être une victime de sa malédiction, le personnage principal ne reste obsédé que par un désir de pouvoir égoïste grâce à l’utilisation de ses nouveaux pouvoirs (hypnose, boire le sang de tous ceux qui le ralentit). Sa distance entre l’homme et le monstre s’avère très mince. Or, il accomplit sa théorie selon laquelle un homme devenant un monstre peut redevenir ce qu’il est. Subissant sa monstrueuse transformation, Barnabas arrive à se contrôler au fil de l’intrigue. A l’inverse, la sorcière Angélique, voulant incarner une image idyllique de l’entreprise, prétend être l’idéal humain pour ses habitants. Mais, faible à cause de l’amour pour le vampire, elle se laisse désabusée par une haine jalouse, la rendant fragile d’abord moralement puis à l’état littéral. Son image finale est proprement magnifique, car elle illustre parfaitement sa personnalité déchirante avec poésie et cruauté. Tour à tour possessive, désespérée et exubérante, son chagrin fou en devient pathétique et la rend presque touchante. Plus généralement, l’histoire évolue de sorte que la vraie personnalité de chaque membre de la famille Collins se révèle dans un final grandiose et surréaliste, où Tim Burton semble prendre son plaisir à mettre en avant la personnalité du manoir, théâtre de conflits dramatiques et de phénomènes paranormaux.

Si l’évolution de chaque protagoniste est captivante, elle est néanmoins gâchée par un manque d’unité narrative dans l’histoire. Le début est exemplaire dans sa présentation du contexte, des personnages pittoresques et de l’introduction des enjeux narratifs. La fin demeure un festival jouissif avec une dramaturgie encore plus forte émotionnellement parlant. Cependant, le milieu du film tourne en rond car l’intrigue colle trop à la structure mélodramatique de la série. Du coup, les intrigues se multiplient mais peinent à se développer, faute de temps. Certains personnages se retrouvent malheureusement peu approfondis malgré le postulat intéressant, comme le docteur alcoolique (Helena Bonham Carter) ou la mystérieuse gouvernante tourmentée (Bella Heathcote). Le scénario accuse une certaine maladresse dans sa structure mais gère avec brio son contraste établi entre les différentes époques.

Le contraste entre la comédie et la tragédie s’entend aussi dans ce film. La musique de Danny Elfman s’occupe de morceaux grandioses et pesants, soulevant la tension des situations. Mais elle est contrebalancée par l’irruption de tubes des années 70 (T. Rex, Moody Blues, Barry White, Carpenters, etc.). Ce mélange musical donne ainsi un cachet particulier au film. Il règne ainsi une cohésion pertinente entre tous ces éléments qui semblent différents mais qui sont réunis au simple profit du décalage pur des coutumes traditionnelles.

Complexe par sa forme et par son fond, Dark Shadows de Tim Burton apparaît tour à tour comme une tragédie romantique gothique, un drame familial, un film d’épouvante, une comédie noire baroque. S’inspirant d’une multitude d’atmosphères hautes en couleur, c’est ce qui peut perturber le spectateur mais c’est en tout point sa qualité principale. Aussi délirant soit-il, le film est un divertissement complet pour le spectateur, émotions et rires garantis. Malgré la maladresse de l’histoire, on sent Tim Burton donner à foison toutes ses passions aussi bien visuelles et thématiques : le décalage entre les époques, l’homme et le monstre, l’amour meurtri, la vision ironique sur la société de consommation, la recherche d’un amour fraternel, les blessures de personnages laissés-pour-compte, etc. Autan de thèmes aussi riches et aussi divers pour laisser s’exprimer le talent de chaque acteur et la vision du réalisateur. Parfaite tragi-comédie horrifique, Tim Burton s’approprie complètement la série originale pour essayer de donner ce qu’il y a de meilleur dans son cinéma, c’est-à-dire la description de personnages fragiles et rejetés, sous fond de critique sociale acerbe, à coup de partis-pris particuliers pouvant choquer les spectateurs.
FRANKENWEENIE : la nostalgie d’un créateur face à ses premiers travaux

Le projet « Frankenweenie » est d’une grande importance pour Tim Burton. Tant dans sa forme que dans son fond, il réunit toutes les obsessions du cinéaste pour en tirer un exutoire sur son enfance passée. Ce fut d’abord un court-métrage en 1984. Etant étudiant au sein de l’industrie Disney, Burton n’accordait que très peu son univers personnel aux exigences des producteurs. En réalisant Vincent (1982), il n’attirait pas les managers, ne sachant quoi faire de son court-métrage. Trop noir pour être montré à la vue de petits enfants, ils le rangeaient simplement dans leur tiroir des projets abandonnés. Seulement, la productrice Julie Hickson encouragea de nouveau le jeune Tim Burton à continuer son parcours. Lui vient l’idée d’un hommage aux films d’épouvantes classiques sous forme de pastiche enfantine. Ainsi, de l’inspiration du roman de Mary Shelley, le futur cinéaste en retire une fable attachante sur la vie et la mort. Victor Frankenstein, alors à son plus jeune âge, décide de ramener à la vie le seul ami auquel il tenait : son chien Sparky. Cependant, si l’expérience s’avère pertinente, ce n’est sans compter la réaction des voisins face à cette résurrection fantastique. Tournant l’histoire en prises de vue réelles, Burton insuffle sa poésie et ses thèmes préliminaires d’une manière plus innocente. Nous retrouvons dans cette œuvre-ci l’amour porté au personnage reclus, la critique d’une société morose qui prétend vivre dans une société « normalisée », le manque d’amour et la recherche d’un réconfort. Malgré cela, le réalisateur découvrit les contraintes que peuvent donner les grands studios d’Hollywood. Imposé sur un format court, Frankenweenie de 1984 est trop hâtif dans sa narration, ce qui fait que les retournements de situation ne semblent pas naturels.

Bien des années plus tard, Tim Burton acquit suffisamment de notoriété auprès du public. Après le grand succès financier d’Alice au pays des merveilles (2010), il décide de remettre le dossier Frankenweenie au nez des producteurs de la société aux grandes oreilles. Burton étant maintenant gage de succès, ceux-ci acceptent spontanément la révision de cette œuvre chère au cinéaste. Réadaptée en long métrage de 87 minutes, le réalisateur à la coiffure excentrique décide de traiter l’histoire en animation image par image, gardant le noir et blanc du court-métrage original. Le plus grand changement fut celui-ci : Burton souhaita retrouver de vieilles connaissances dans son casting, tel Winona Ryder (Edward aux mains d’argent), Martin Short (Mars Attacks !), Catherine O’Hara (Beetlejuice) et Martin Landau (Ed Wood). Sorti pour Halloween 2012, ce nouveau film fit un échec financier juste après le controversé Dark Shadows mais suscita, contrairement à ce dernier, l’approbation générale du public.

Il faut dire que rare était les personnes impatientes de voir cette nouvelle œuvre. Refaire un ancien travail avec une recette déjà connue relevait de la facilité. Pourtant, Tim Burton s’empare de cette esquisse originale pour s’impliquer d’une manière beaucoup plus personnelle. A travers ce récit connu, il tisse dans la vie du jeune Victor un espace riche de souvenirs d’enfance. Ainsi, le spectateur suit un Frankenstein bricoleur de films super 8, voulant être scientifique fou, mais incompris de ses camarades étranges et de son père maladroit. Seul son chien arrive à le consoler par simple tendresse. Le jeune héros principal est identifié comme un portrait romancé de son créateur, réclamant un désir d’amour perdu après la mort de son chien. Naviguant entre un père qui souhaite lui imposer ses projets et une jeune voisine timide et manipulée par son père, le maire ahuri, Viictor n’arrive plus faire la part des choses. Seul son professeur de sciences, majestueux personnage bigarré, l’aide vraiment à chercher ce qu’il souhaite réellement. Doublé admirablement par Martin Landau, ce personnage se révèle en particulier touchant dans sa manière de concevoir les choses. Son aura inquiétante présume ce qui suit : les apparences peuvent s’avérer trompeuses. Si les camarades de Victor se révèlent antipathiques, ils en deviennent étrangement attachants par leur singularité et leur grain de folie. L’exemple le plus frappant est Edgar, enfant bossu hérité d’Igor peu fréquentable par ses idées mal reçues, mais qui est attachant grâce à sa vulnérabilité influençable. A travers les personnages et les évènements du scénario, Burton s’amuse à multiplier les références au genre fantastique, que ce soit les films qui ont bercé sa jeunesse (un truculent cameo de Christopher Lee en Dracula, Gamera ennemie de Godzilla, L’Etrange Créature du Lac Noir et tous les classiques d’épouvantes du studio Universal) ou les films plus « récents (Gremlins, Jurassic Park, etc.). Parodiant les clichés des histoires horrifiques (l’oracle, l’attaque des monstres) avec son humour à la fois ironique et enfantin, le cinéaste se permet de se moquer gentiment de la production mère, avec une musique inspirée de Danny Elfman.

Bien que le film soit généreux en thèmes et en séquences délirantes et poétiques, le spectateur peut regretter une certaine prévisibilité dans ce long-métrage. Si Dark Shadows souffre de sa narration tout à fait maladroite, Frankenweenie de 2012, lui, peine à se détacher du court-métrage original, recopiant au plan près les mêmes séquences. De plus, l’accumulation de références en tous genres donne l’impression au spectateur de repartir dans une aventure aux ficelles déjà usées dans le cinéma de Burton, principalement Edward aux mains d’argent (1990).
Malgré ce manque de réelle surprise, le remake de Frankenweenie se rattrape dans sa faculté de parler de l’enfance du cinéaste avec douceur et humour. S’adressant à un public plus large que les précédentes œuvres de Burton (Sweeney Todd, par exemple), ce long-métrage d’animation reste superbe dans l’animation de ses figures et assure son aspect rétro en maniant justement les moments humoristiques et les coups de théâtre dramatiques. Avec l’exposition à la Cinémathèque, Dark Shadows, le remake de Frankenweenie, un fascinant clip lyrique tourné pour le groupe The Killers, on peut dire que Tim Burton a dévoilé son univers artistique sous toutes les coutures et avec plus ou moins de réussite.

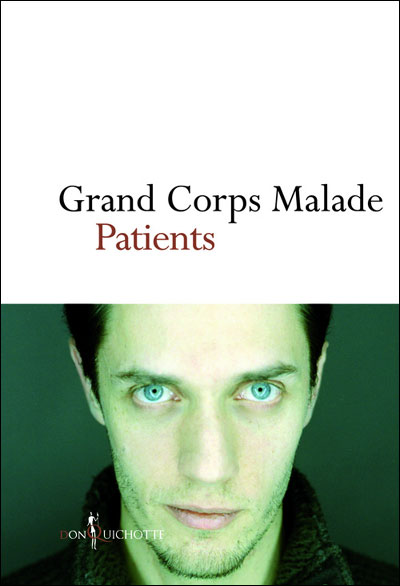

1 Comment
Lilith
1 mars 2013 at 22:40La rencontre a du être fantastique. En tout cas, tu en parles de manière très touchante!